Un master humanitaire est une formation de deux ans. Elle prépare les étudiants aux défis internationaux, aux droits de l’homme et à l’action humanitaire. Ce programme est classé niveau 7 au RNCP et équivaut à un bac +5.
Il offre 120 crédits ECTS. Il mélange théorie et pratique. Le cursus inclut le droit, la science politique et les sciences sociales.
Points Clés
- Un master humanitaire dure deux ans après un bac +3.
- Le diplôme est classé niveau 7 au RNCP.
- 120 crédits ECTS à l’issue de la formation.
- Inclut des enseignements pluridisciplinaires en droit, science politique et sciences sociales.
- Les débouchés incluent le coordonnateur de projets humanitaires et juriste spécialisé en droit humanitaire.
Introduction au master humanitaire
Le master humanitaire répond aux besoins d’expertise humanitaire partout dans le monde. Il dure deux ans. Son but est de former des professionnels pour gérer les crises internationales et poursuivre le développement durable.
Objectifs et perspectives
Le but du master humanitaire est de former des experts en gestion de crises et développement international. Les diplômés peuvent travailler dans des ONG, agences internationales et institutions spécialisées. Ils apprendront à communiquer entre cultures, gérer des projets et analyser les politiques publiques.
Le but est d’améliorer l’efficacité et la durabilité des interventions humanitaires.
Écoles et universités proposant le cursus
Beaucoup d’universités et d’institutions offrent ce programme. En France, Sciences Po Paris et IEP Grenoble sont parmi les premières. Ces programmes combinent théorie et pratique pour former des experts.
Cours fondamentaux dans un master humanitaire
Dans un cours master humanitaire, les étudiants découvrent des domaines clés. Ils apprennent à agir dans les crises mondiales. Le programme offre une base solide en théorie et pratique humanitaire.
Droit international humanitaire
Le droit international humanitaire est essentiel. Ce cours enseigne les droits de l’homme, le droit pénal international et les conventions de Genève. Les étudiants apprennent à protéger les civils et à agir de manière éthique pendant les interventions.
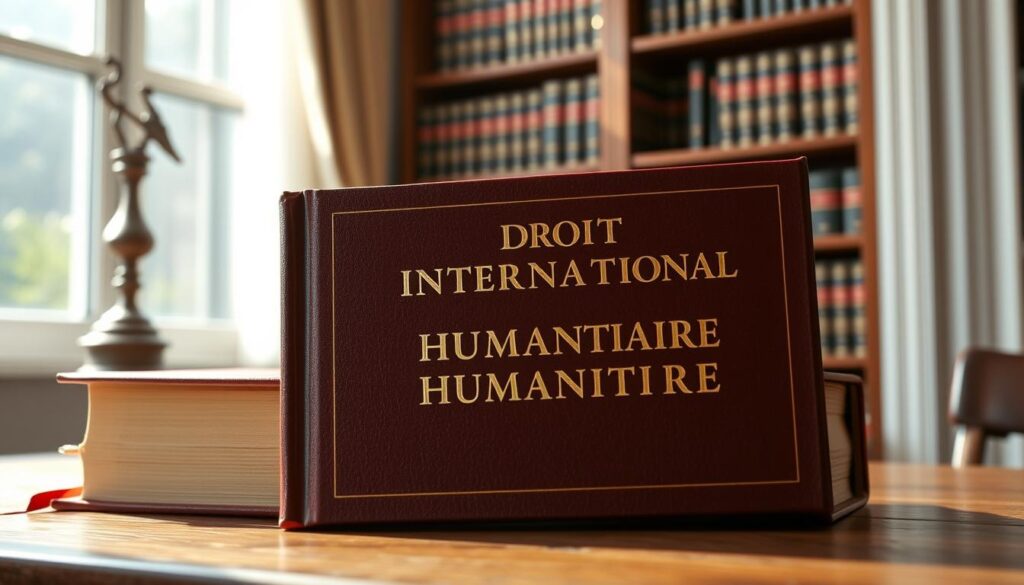
Science politique et relations internationales
Les cours de science politique et de relations internationales expliquent les dynamiques politiques mondiales. Ils abordent la géopolitique, les enjeux actuels et les relations diplomatiques. Ces connaissances aident les étudiants à comprendre les crises humanitaires et à élaborer des stratégies d’intervention.
Sociologie et analyse des crises
La sociologie est cruciale pour gérer et analyser les crises. Les cours examinent les causes et effets des guerres, des catastrophes naturelles et d’autres crises. Les étudiants apprennent à utiliser des outils sociologiques pour évaluer l’impact des crises et développer des réponses efficaces.
Ateliers et travaux pratiques
Les ateliers master humanitaire permettent aux étudiants de vivre des situations réelles. Ils simulent des urgences, créent des projets humanitaires et gèrent des crises. Cela les prépare au terrain.
En 2023-24, la plateforme Eduniversal Matching aide les étudiants. Ils peuvent évaluer leurs chances avant de s’engager. Cela les prépare mieux aux travaux pratiques.
Le master de Strasbourg combine théorie et pratique. Il comprend des séminaires et ateliers pour mieux comprendre les problèmes humanitaires. Les étudiants apprennent à gérer des crises.
Les programmes comme celui de Bioforce consacrent 40 % du temps aux simulations. Ils incluent la gestion de l’eau et de l’assainissement en crise. Une période d’application de 6 mois est requise pour finir la formation.
Les étudiants apprennent à gérer des projets et à communiquer. Ils deviennent chefs de mission dans les ONG. 87 % d’eux partent en mission humanitaire après leur formation.
Projets et études de cas
Cette section du programme encourage les étudiants à appliquer leurs connaissances à des projets réels. Ils apprennent à concevoir, planifier et mettre en œuvre des projets humanitaires. Ils analysent aussi les politiques publiques pour comprendre leur impact sur les interventions humanitaires.
Gestion de projets humanitaires
Dans la gestion de projets humanitaires, les étudiants apprennent des aspects clés. Ils étudient la planification stratégique, la recherche de financement et la coordination d’équipe. La formation vise à développer des compétences pratiques pour gérer des projets complexes dans différents contextes.
La collaboration avec des professionnels du réseau NOHA enrichit l’apprentissage. Cela assure une approche pratique et enrichissante de la gestion de projets humanitaires.

Analyse des politiques publiques
L’analyse des politiques publiques est cruciale dans le programme. Les étudiants apprennent à évaluer l’impact des décisions politiques sur les interventions humanitaires. Ils étudient des cas réels pour acquérir les compétences nécessaires.
Leur travail inclut la critique des politiques existantes et la formulation de recommandations. Cela vise à optimiser leur mise en œuvre sur le terrain.
| Statistiques | Données |
|---|---|
| Nombre d’étudiants préparés par an | Environ 60 |
| Praticiens de terrain parmi les formateurs | Plus de 70% |
| Collaborations avec des professionnels | Écoles de formation et professionnels du secteur |
| Langues d’enseignement | Français, Anglais, Espagnol |
Expérience professionnelle: stages et alternance
Le master humanitaire met un grand accent sur l’expérience professionnelle. Les étudiants peuvent faire des stages master humanitaire en France ou à l’étranger. Ces stages sont cruciaux pour acquérir des compétences pratiques et une expérience sur le terrain.
Stages en France et à l’étranger
Les stages peuvent se passer en France ou à l’international. Cela permet aux étudiants de travailler dans différents contextes. Travailler à l’étranger est une expérience culturelle et professionnelle enrichissante pour beaucoup.
- Participer à des missions de gestion de crises sanitaires et alimentaires
- Travailler sur le terrain avec des organisations internationales comme Médecins Sans Frontières ou la Croix-Rouge
- Contribuer à des projets sur les droits de l’homme et la protection des populations vulnérables
Les expériences sont soutenues par une méthodologie rigoureuse. Le classement Eduniversal considère la notoriété des institutions et les témoignages des diplômés.
Soutenances et mémoires de recherche
Après le stage, les étudiants doivent rédiger un mémoire de recherche. Ce travail se termine par une soutenance orale. Ce processus permet de consolider les acquis et d’analyser des sujets spécifiques.
- Capacité à analyser des données empiriques recueillies lors des stages
- Développement d’un argumentaire solide et cohérent sur un sujet d’actualité
- Présentation des résultats de manière claire et convaincante
La partie pratique est très importante. Par exemple, le master projet humanitaire en alternance à Paris alloue 50 % du temps aux stages. Cela permet une bonne combinaison de théorie et de pratique.
Lieux d’étude et mobilités internationales
Les étudiants en master humanitaire peuvent étudier à l’étranger grâce à des échanges universitaires. Plus de 300 universités partenaires sont disponibles, en Europe et ailleurs. Cette mobilité internationale aide à mieux comprendre les défis mondiaux.
Elle prépare aussi les étudiants à des carrières internationales dans l’humanitaire. Beaucoup d’étudiants reçoivent des bourses pour leur mobilité. Mais ces bourses ne couvrent pas tous les frais.
Il faut donc bien planifier son budget pour les dépenses de transport, de vie, de logement et de nourriture.
La mobilité est une partie du cursus. Les étudiants peuvent passer des examens avec les étudiants locaux. Les notes obtenues à l’étranger sont reconnues dans leur université d’origine.
Un relevé de notes est édité après validation de la période d’études. Les stages Erasmus+, par exemple, sont ouverts aux étudiants d’établissements supérieurs Erasmus+. Les stagiaires à l’étranger reçoivent un soutien Erasmus+ de 2 à 12 mois.
Les candidatures pour la mobilité doivent être faites en ligne entre décembre et janvier. Les sélections des candidats se font en février ou mars. Chaque année, entre 10 et 20 étudiants, de différents domaines, partent travailler à l’étranger grâce au programme d’échange d’assistants de langue.
Cette expérience enrichit académiquement et culturellement. Elle développe des compétences linguistiques essentielles pour une carrière dans l’humanitaire.

